Tatouages, piercings : plus que deux mois d'attente pour donner son sang
Alors que la rentrée bat son plein, l’Établissement français du sang (EFS) relance son appel à la générosité. Chaque année, un million de malades sont soignés grâce aux dons de sang, de plasma et de plaquettes. Pourtant, ces produits vitaux restent impossibles à fabriquer artificiellement.
Le don, un geste à inscrire dans son quotidien
À l’heure où chacun reprend son rythme après l’été, l’EFS invite à faire du don de sang un réflexe régulier. Les possibilités sont multiples : don de sang total toutes les huit semaines, jusqu’à quatre fois par an pour les femmes et six fois pour les hommes ; don de plasma toutes les deux semaines, jusqu’à vingt-quatre fois par an ; et don de plaquettes toutes les quatre semaines, jusqu’à douze fois par an.
Des changements dès le 1er septembre
L’actualité de cette rentrée est aussi marquée par l’évolution de certains critères de sélection des donneurs. À partir du 1er septembre, l’ajournement lié à un tatouage, un piercing — y compris les boucles d’oreilles — ou encore à une séance d’acupuncture sera réduit de quatre à deux mois. Autre assouplissement : l’ajournement disparaît après la pose de substituts osseux utilisés en implantologie dentaire.
Un cadre fondé sur les progrès médicaux
Ces ajustements reposent sur deux constats : l’amélioration notable des pratiques d’hygiène dans les salons de tatouage et de piercing, et les avancées technologiques en matière de dépistage. Le recours au dépistage génomique viral permet en effet de détecter plus précocement d’éventuelles infections, en réduisant la période dite de « fenêtre silencieuse », notamment pour l’hépatite C.
Une vigilance inchangée sur la sécurité
L’EFS insiste : si les conditions d’accès au don évoluent, la sécurité reste un impératif absolu. La qualité des produits sanguins et la protection des donneurs ne souffrent d’aucune concession.
Une décision collective et encadrée
Ces évolutions s’inscrivent dans un processus de révision régulier des critères de sélection. Elles résultent d’un travail conjoint entre la Direction générale de la Santé, l’Agence nationale de sécurité du médicament, Santé publique France, l’EFS, le Centre de Transfusion Sanguine des Armées, ainsi que des experts scientifiques et des représentants de la société civile.
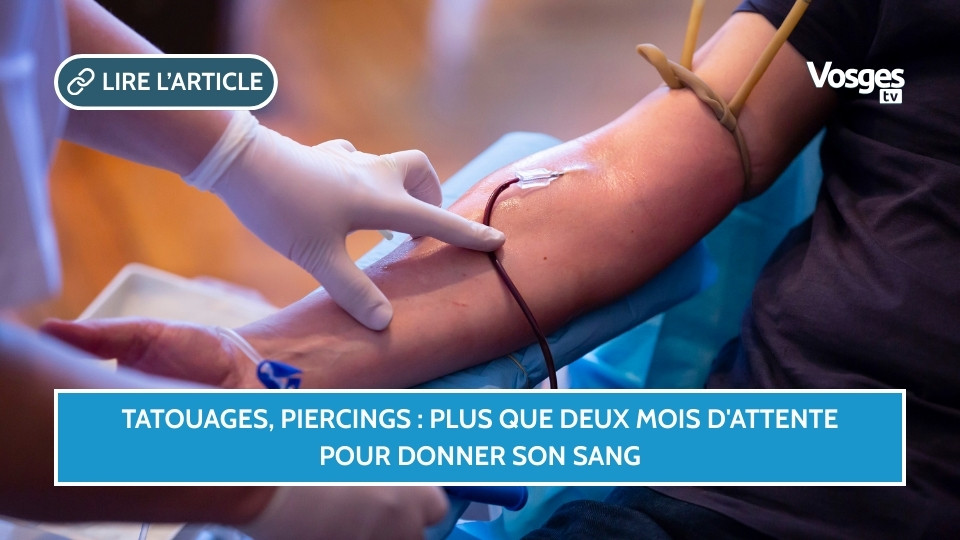
Laissez nous un commentaire